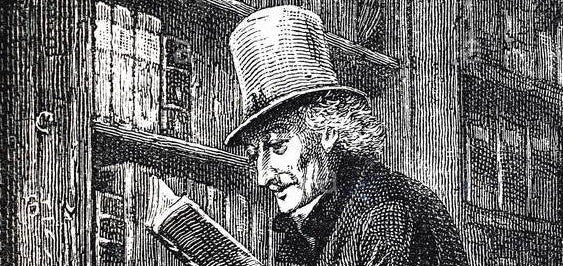
Petit lexique de bibliophilie
Share
Petit lexique de bibliophilie
Parce qu'on aime mieux ce que l'on connait bien : voici un petit lexique (très incomplet et très partial !) de bibliophilie à l'usage de l'amateur.
***
Achevé d'imprimer : Dans les livres modernes, page mentionnant la date et le lieu d'impression du livre.
Adresse : Partie inférieure de la page de titre indiquant le lieu d'édition, le nom de l'éditeur et la date de publication.
Almanach : Livre populaire qui donnait des renseignements d'astrologie, de météorologie, un calendrier détaillé, etc. Au XVIIIe, l'almanach devient prisé par l'aristocratie et se pare de gravures sur cuivre, de reliures luxueuses. Il devient un cadeau offert au nouvel an.
Bandeau : Ornement gravé sur cuivre ou sur bois en tête de la page.
Barbes (pour le papier) : Franges de la feuille avec des irrégularités provoquées par les inégalités du papier aux limites de la forme.
Basane : Peau de mouton tannée avec des substances végétales. Ce cuir, à fleur unie et à chair assez lâche, est utilisé pour les reliures ordinaires de teinte naturelle, notamment au XVIIIe siècle.
Brevet : Privilège accordé à des imprimeurs-libraires sous l'Ancien Régime qui obtenaient l'autorisation exclusive de l'impression et de la mise en vente d'un livre.
Cabinet de lecture : Vers 1770, libraire qui permettait aux lecteurs dont le pouvoir d'achat était limité de lire les nouveautés sur place en échange d'une modeste contribution financière. Le premier libraire connu ayant mis en place un tel cabinet de lecture est le libraire Gabriel-François Quillau.
Censure : Examen ordonné par le pouvoir avant d'autoriser ou non la publication d'un écrit. Sous l'Ancien Régime, la censure relève du Chancelier, lequel nommer nomme un Inspecteur Général de la Librairie qui, lui-même, confie la surveillance au Lieutenant de Police.
Cahier : Feuille ou partie de feuille de papier qui, après pliure, forme un tout et porte une signature permettant l'assemblage. Un livre est constitué de plusieurs cahiers assemblés et cousus ensembles.
Cartonnage : Reliure spéciale d'éditeur dont le dos et les plats sont décorés de fers spéciaux. Les cartonnages éditeur sont typiques du XIXe et du début du XXe siècle.
Chagrin : Peau de chèvre ou de mouton présentant un grain très accentué et utilisée en reliure.
Coiffe : Rebord incurvé qui surmonte le dos du volume, en tête et queue. On la façonne à partir du repli de peau.
Collation : Examen attentif d'un exemplaire dans le but de vérifier s'il est bien complet de toutes ses pages, gravures, cartes, etc.
Colophon : Texte final indiquant le nom de l'imprimeur et la date d'achèvement. De nos jours, le colophon est remplacé par l'achevé d'imprimer.
Coquille : Faute de composition.
Couverture conservée : Mention indiquant que le relieur a relié le livre avec sa couverture d'origine.
Couvrure : Opération du relieur, consistant à recouvrir un volume d'une peau, d'une toile ou d'un papier.
Cul-de-lampe : Ornement décoratif gravé sur bois ou sur cuivre, placé en fin de chapitre.
Demi-reliure : Reliure sur laquelle le dos et le premier quart des plats d'un livre sont couverts par le cuir ou la toile. Le reste des plats est couvert par du papier, marbré ou uni. Lorsque les coins sont couverts de cuir ou de toile, on parle alors demi-reliure à coins. Si une bande de cuir ou de toile recouvre toute la hauteur des plats du côté opposé au dos, on parle alors demi-reliure à bandes.
Dédicataire : Personne à qui un livre est dédié.
Envoi : Dédicace manuscrite faite par un auteur.
Epidermure : Altération superficielle d'une reliure de peau.
Estampé à froid : Lettre ou motif poinçonné en creux sur les reliures sans application d'or ou de couleur.
Ex-dono : Note manuscrite, généralement sur l'intérieur de la page de garde ou le faux titre, indiquant à qui l'ouvrage a été donné par l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur ou un tiers.
Ex-libris : Au Moyen-âge, désigne exclusivement l'inscription apposée sur un livre pour en indiquer le propriétaire. Par la suite, vignette dessinée ou gravée que les bibliophiles collent au revers des reliures et qui porte, imprimé ou manuscrit, leur nom ou leur devise.
Fac-simile : Reproduction exacte d'une écriture manuscrite, d'un texte imprimé, d'une photographie, d'un tableau avec des moyens photomécaniques.
Faux titre : Tire abrégé placé sur la page qui précède celle de titre et imprimé en plus petits caractères.
Feuille : format de papier tel qu'il arrive entre les mains de l'imprimeur. À distinguer du « feuillet » (ou folio), qui se compose de 2 « pages » (une recto, et une verso).
Filigrane (ou Marque d'eau) : Empreinte laissée dans la feuille de papier et visible par transparence. Le filigrane était la marque du fabriquant du papier.
Foliotage : Numérotation des feuillets. Le premier livre folioté fut le Tacite de Jean de Spire, publié à Venise en 1469, Cette pratique fut abandonnée au XVIe et remplacée par la pagination, numérotant chaque page.
Format : Dimensions d'un livre qui, en bibliophilie, ne s'exprime pas en centimètres mais en fonction du pliage de la feuille et de la dimension de base de celle-ci :
- In plano : la feuille n'est pas pliée lors de l'impression. Ce qui donne des formats très grands, 1 feuille, donnant 2 pages.
- In folio (ou in-f°) : la feuille est pliée 1 fois, donnant 2 feuillets, soit 4 pages.
- In quarto (ou in-4°) : la feuille est pliée 2 fois, donnant 4 feuillets, soit 8 pages (l'équivalent d'un grand format actuel, autour de 20x30 cm).
- In octavo (ou in-8°) : la feuille est pliée 3 fois, donnant 8 feuillets, soit 16 pages (l’équivalent d'un livre un peu plus grand qu'un livre de poche actuel).
- In douze (ou in-12°) : la feuille est pliée de manière à obtenir 12 feuillets, soit 24 pages.
Frontispice : Gravure placée en regard du titre.
Gardes : Feuillets blancs ou de couleurs variées qui commencent ou qui terminent un livre. Ce sont le plus souvent des papiers marbrés. Dans les reliures de luxe, le papier peut être remplacé par des gardes de soie, de velours ou de maroquin.
Gouttière : Tranche d'un livre opposée au dos et généralement concave. Nommée ainsi à cause de sa forme traditionnellement concave, due à l'endossement du livre au moment de sa reliure.
Grands papiers : Se dit d'éditions tirées sur papier de luxe (chine, japon, madagascar, hollande), imprimé à un nombre restreint d'exemplaires et numérotés.
Hors-texte : Gravure imprimée sur une page entière et ne comportant pas de texte autre que celui, très court, relatif à cette gravure (titre de la gravure, nom du graveur ou du dessinateur...)
Imprimatur : Autorisation d'imprimer donnée par l'autorité ecclésiastique.
Incunable : Ouvrage imprimé avant 1501. Certains bibliophiles nomment post-incunable un ouvrage imprimé entre 1501 et 1530-40.
Janséniste : Se dit d'une reliure pleine et sans ornement.
Justification du tirage : Dans les livres modernes, page mentionnant la date, parfois le lieu d'impression du livre, le papier employé, etc...
Keepsake : Petit livre illustré de jolies et fines gravures, dont la mode est venue d'Angleterre, et qui étaient offert à l'occasion du jour de l'an. Particulièrement fréquents entre les années 1820-1840.
Livre broché : Ouvrage à couverture souple, dont les cahiers ou les pages sont assemblées par collage au dos. Sa finition la plus courante est le dos carré collé.
Maroquin : Peau de chèvre tanné à grain très large et très apparent.
Marque d'imprimeur : Vignette utilisée par un imprimeur ou un libraire pour indiquer son rôle dans l'édition d'un livre.
Mors : Saillies longitudinales dans lesquelles se logent les cartons des plats. Par excès de langage, parfois nommées charnières (lesquelles désignent l'articulation des livres médiévaux).
Mouillures : Taches d'une teinte jaunâtre, plus foncées sur les bords, causées sur le papier par une empreinte humide.
Nerfs : Saillies qui se remarquent au dos des livres et qui sont produites par les ficelles sur lesquelles on fait passer la couture et qui relient les cahiers. A l'origine, ces nerfs étaient de véritables boyaux roulés. Aujourd'hui, les nerfs que l'on voit au dos des livres sont en fait de faux-nerfs. Les cahiers du livre étant grecqués (sciés dans le sens de la largeur), la ficelle autour de laquelle on tourne le fil de lin lors de la couture ne fait plus saillie au dos. Les nerfs que l'on retrouve sont moulés sur des bandes de cuir ou de carton.
Parchemin : Peau de veau mort-né, de mouton ou de chèvre, préparée spécialement pour recevoir l'écriture. Au Moyen-Âge, le parchemin était utilisé pour calligraphier les manuscrits. Plus tard, on l'a utilisé pour la couvrure des livres.
Papier de Chine : Papier de teinte légèrement grisâtre fabriqué à partir d'herbes et de plantes fibreuses telles que le chanvre, le jute, le fin, la ramée (herbe chinoise), le rotin, le bambou, le roseau, les tiges de riz et du blé et les fibres de graines telles que le coton. La fabrication du papier en Chine remonterait à l'an 105 de notre ère.
Percaline (ou percale) : Toile de coton, souvent lustrée, servant à la couvrure des livres à partir du XIXe siècle. Moins chère que le cuir (et industrielle), son usage se généralise rapidement, jusqu'à quasi disparaître entre deux Guerres.
Pièce de titre : Petite pièce de cuir collée au dos, indiquant le titre de l'ouvrage. Une pièce de même nature peut être utilisée pour indiquer le tome : on parle alors de pièce de tomaison.
Piqué : Exemplaire qui présente des taches sombres, de moisissures ou de rousseurs,
Plat : Cartons formant la couverture d'un livre relié et sur lesquels est appliquée la matière de recouvrement : cuir, toile, papier marbré, etc. On appelle contre plat le verso d'un plat. On distingue le premier plat et le second plat.
Princeps : S'emploie pour la première édition imprimée d'un texte ancien ou classique.
Pur fil : Papier fait de chiffons et fabriqué de nos jours sur des machines industrielles lentes. Le nom de la fabrique est généralement joint : Arches, Johannot, Marais, Rives, Lafuma...
Reliure à la Bradel : Inventée vers 1775 par le relieur Pierre-Jean Bradel, la reliure à la Bradel est une forme de reliure dans laquelle les cartons sont placés en retrait des mors, formant ainsi des sillons facilitant l'ouverture du livre. Ce cartonnage, couvert de papier ou de toile, n'était à l'origine qu'une reliure provisoire, en attente de la reliure définitive. Par leur habileté, les relieurs ont donner à la reliure à la Bradel ses lettres de noblesses, mêlant l'élégance et simplicité.
Rousseurs : Taches jaunâtres ou brunâtres affectant le papier, surtout ceux qui ont été trop ou mal blanchis au moment de leur fabrication. Elles sont le résultat d'un mauvais entreposage, d'agents organiques ou de l'acidification d'un papier de mauvaise qualité.
Serpente : Feuille faite d'un papier très mince et sans colle, destinée principalement à protéger les gravures contre le maculage.
Signet : Petit ruban attaché à la tranchefile d'un livre et servant à marquer l'endroit où l'on a interrompu sa lecture.
Suite de gravures : Tirage spécial des gravures d'un ouvrage, souvent imprimées sur un papier de qualité différente, et insérées dans certains exemplaires de luxe de cet ouvrage.
II peut aussi s'agir d'épreuves d'états. Dans ce cas, la suite devient un document des plus intéressants sur l'évolution de l’œuvre gravée.
Tranchefile : Broderie en fils de soie de couleurs, placée en tête et en queue du corps d'ouvrage. Ce petit bourrelet entouré de fils, garnit et renforce le haut et le bas du dos d'une reliure afin de maintenir les cahiers assemblés ; il renforce par ailleurs les coiffes. Dans les reliures à dos brisé, il empêche la poussière de s'infiltrer entre le corps d'ouvrage et le dos de la reliure.
Truffé (exemplaire) : Se dit d'un exemplaire enrichi de documents en rapport avec son thème, mais qui ne font originellement pas partie de l'édition en question. Par exemple : des autographes, manuscrits, photographies, souvenirs de diverses natures, etc. Cela en fait un exemplaire unique dont la valeur peut être importante.
Veau : Peau tannée servant à la reliure.
Vélin : Papier sans grain, lisse et satiné, qui rappelle par sa très grande finesse la peau de vélin. Se dit aussi en général de tout papier qui n'est pas vergé. Désigne également un parchemin en peau de veau.
Vergé : On appelle papier vergé celui qui laisse apercevoir par transparence les empreintes des fils métalliques (vergeures et pontuseaux) formant le fond du moule dans lequel il a été fabriqué. La même texture est donnée à des papiers (à la mécanique) qui portent le nom de vergé.
Vignette : Petite illustration gravée sur bois ou cuivre.
